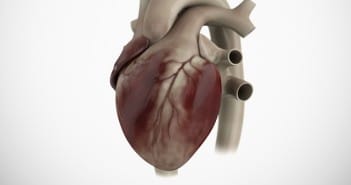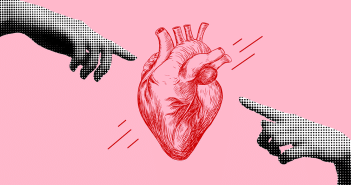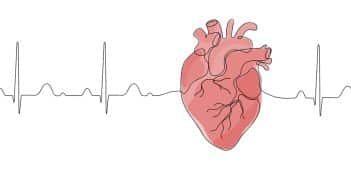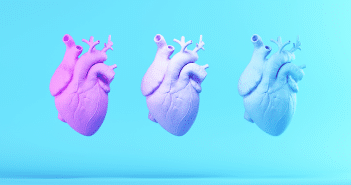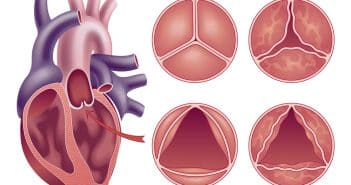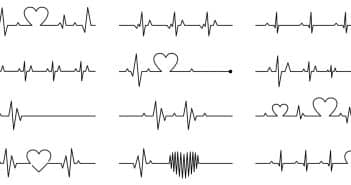Les limites de la raison (suite) : quand la mémoire s’efface, l’histoire recommence
“… nous devons accepter une vérité fondamentale :
nous sommes tous le produit d’une époque et d’un lieu particuliers.”
Dans Laurence Rees, La pensée nazie. Éditions Arpa, 2025, 546 p.
J’ai interrompu il y a déjà plusieurs mois une série d’articles sur “Les limites de la raison”. Cette série parlait entre autres de biais cognitifs et proposait une synthèse de divers ouvrages de psychosociologie. Après plusieurs billets consacrés à la déferlante “intelligence artificielle”, il m’a semblé utile, au prisme de diverses lectures récentes et de l’actualité, de reprendre cette série où elle s’était arrêtée.
Dans ce billet, nous allons voir, à travers quelques exemples, que la vérité est complexe, qu’il est facile de la travestir, et que de ne pas faire preuve d’esprit critique peut conduire à ce que l’histoire recommence dans ses aspects les plus dramatiques.