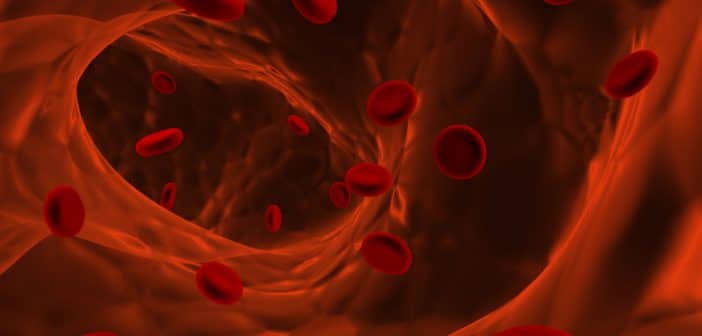Les résultats des deux études de référence BENESTENT [10] et STRESS [11], en démontrant la supériorité de l’angioplastie avec stenting par rapport au ballon seul dans le traitement des lésions simples siégeant dans une artère native grâce à une diminution de la resténose angiographique à 6 mois, contribuèrent largement au développement et à la généralisation du recours au stenting. Les nombreux raffinements apportés aux techniques d’implantation et l’évolution technologique des stents conduisirent à un essor considérable du taux d’utilisation de cette stratégie thérapeutique et à un élargissement de ses indications.
Cependant, malgré l’amélioration incontestable des résultats de l’angioplastie coronaire obtenue grâce aux stents nus, un taux irréductible de resténose, aux alentours de 20 à 30%, au site d’implantation du stent continuait à obérer le pronostic à long terme de la technique [12-14] la rendant inutilisable, en particulier chez les patients à lésions multiples, avec un risque de récidive multiplié.
Les stents actifs: l’enthousiasme et la polémique
C’est dans ce contexte que fût envisagé l’association prothèse et agents pharmaceutiques inhibiteurs de prolifération néo-intimale afin de franchir l’obstacle de la récurrence sténotique désignée comme le “talon d’Achille” de l’angioplastie [15, 16], la substance antiproliférative étant fixée au stent par un polymère qui permettait l’élution progressive de la drogue sur quelques semaines.
RAVEL fut la première étude randomisée évaluant l’efficacité et l’innocuité d’un stent actif à diffusion de sirolimus, agent cytostatique potentiellement inhibiteur du phénomène d’hyperplasie intimale entraînant la resténose intrastent [17]. Présentés lors du congrès de la Société Européenne de Cardiologie en 2001, les résultats du suivi à 6 mois, affichant des taux de resténose, de perte tardive, de revascularisation itérative et de thrombose de 0%, furent accueillis avec émerveillement et enthousiasme et les nouveaux stents dits “actifs” rapidement qualifiés de révolutionnaires.
Dans le sillage immédiat de cette première étude, les nombreux autres travaux réalisés et publiés sur les stents au sirolimus (CYPHER) [18] ou au paclitaxel (TAXUS) [19] montrèrent, de façon constante, la supériorité des stents actifs sur les stents nus, quelles que soient les lésions ou les populations étudiées. En pratique, cette nouvelle avancée technologique a entraîné une diminution du nombre de procédures de nouvelle revascularisation et a permis d’élargir les indications du stenting aux lésions pluritronculaires dans des anatomies plus complexes. Il avait été montré chez l’animal que les médicaments antiprolifératifs libérés par les stents (sirolimus et placlitaxel) retardaient également l’endothélialisation des stents et conduisaient[...]
Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.
Vous êtes abonné(e)
IDENTIFIEZ-VOUS
Pas encore abonné(e)
INSCRIVEZ-VOUS
Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales
S'inscrire