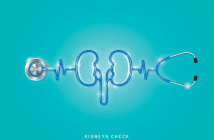Plusieurs éléments convergent actuellement pour faire de ce sujet très à la mode un véritable problème émergent tant de santé publique que plus spécifiquement dermatologique, le/la dermatologue étant amené(e) à prendre des décisions parfois lourdes de conséquences dans de nombreux cas, sollicité(e) par ses collègues oncologues ou autres spécialistes d’organe dans des situations de gestion parfois délicate. Le nombre de patients atteints de tels effets indésirables est en effet en forte croissance, ce qui est lié à l’essor phénoménal des thérapies ciblées utilisées de plus en plus souvent et de plus en plus précocement en oncologie ; il faut également s’y préparer pour répondre de façon -adéquate aux -questions de nos confrères qui sont souvent particulièrement inquiets et mal préparés à affronter ce type de situation. Le dermatologue en tant que spécialiste d’organe va donc très fréquemment se retrouver en première ligne pour prendre des décisions difficiles dans un contexte douloureux et souvent d’urgence, mais où il reste toutefois le plus compétent pour prendre en charge ces effets indésirables qui sont nombreux et parfois limitant en ce qui concerne le traitement antinéoplasique. Dans d’autres cas, le dermatologue est face à des effets indésirables déclenchés par des traitements ciblés qu’il a lui même mis en place dans le cadre de diverses tumeurs cutanées (carcinomes, lymphomes, mélanomes, sarcomes…).
La mise au point de ces diverses thérapies ciblées est bien sûr le fruit du développement rapide de la recherche en oncogenèse moléculaire, avec notamment une dissection de plus en plus précise des voies de signalétique dont des éléments clés peuvent être mutés avec des conséquences inhibitrices ou activatrices sur l’activité de ces différentes voies. Ces thérapies ciblées font appel à des molécules interférant de façon spécifique avec ces voies de signalétique, notamment avec des ligands solubles, des récepteurs membranaires (avec la partie extracellulaire se liant directement avec le ligand ou la région intracellulaire ayant une activité tyrosine kinase), des intermédiaires signalétiques intracellulaires, le protéasome ou encore des modulateurs de transcription de l’ADN (fig. 1). Ces molécules interagissent spécifiquement[...]
Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.
Vous êtes abonné(e)
IDENTIFIEZ-VOUS
Pas encore abonné(e)
INSCRIVEZ-VOUS
Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales
S'inscrire