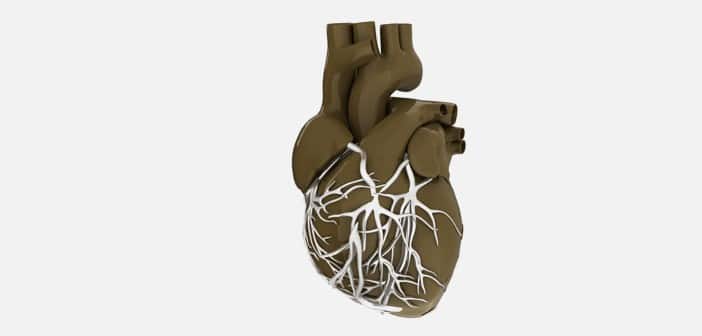La scintigraphie cardiaque est née du besoin d’une procédure non invasive d’évaluation de l’ischémie myocardique. Les premiers traceurs de perfusion myocardique utilisant des isotopes du potassium ont été évalués chez l’animal, entre 1956 et 1960, par Léo Sapirstein. En 1973, le potassium 43 a été testé avec succès dans l’étude de l’infarctus chez l’homme [1], suivi en 1975 par l’utilisation du thallium 201 par Frans Wackers [2].
Depuis, les progrès ont été constants, avec tout d’abord l’apparition de la tomographie, puis de la synchronisation à l’ECG qui permet l’évaluation conjointe de la perfusion et de la fonction ventriculaire gauche. Tout récemment, grâce aux avancées réalisés sur le plan technologique avec l’utilisation de caméra à semi-conducteur (CZT) et, sur le plan pharmacologique, avec l’arrivée récente sur le marché d’un nouveau vasodilatateur destiné aux épreuves de stress (régadénoson), la scintigraphie myocardique reste un moyen d’investigation de premier plan.
Le principe de l’examen
Le principe de la tomoscintigraphie de perfusion myocardique consiste à observer la distribution d’un traceur au sein du myocarde du ventricule gauche dans les conditions de stress et de repos. 60 à 80 % du traceur de perfusion vont être captés au premier passage par les cellules myocardiques, proportionnellement au flux sanguin coronaire régional et à l’intégrité des cardiomyocyte.
Les traceurs technétiés (99mTc-sestamibi et 99mTc-tétrofosmine) ont dorénavant remplacé, dans la plupart des centres, l’utilisation du thallium (201Tl). Le sestamibi et la tétrofosmine sont des cations lipophiles diffusant passivement à travers la membrane cellulaire. Le 99mTc est un émetteur gamma pur de 140 keV, de courte demi-vie (6 heures), bien plus favorable sur le plan dosimétrique que le 201Tl. La dose moyenne d’un examen au 99mTc est deux à trois fois inférieure à celle d’un examen au 201Tl [3].
L’examen, qui vise à mettre en évidence des hétérogénéités de la réserve de flux coronaire, se compose d’une imagerie post-stress, suivie d’une imagerie de repos, réalisée en règle général le même jour. L’imagerie post-stress nécessite une injection du traceur durant l’augmentation[...]
Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.
Vous êtes abonné(e)
IDENTIFIEZ-VOUS
Pas encore abonné(e)
INSCRIVEZ-VOUS
Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales
S'inscrire