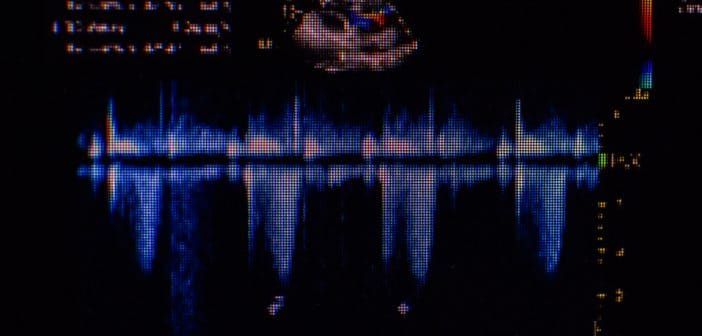Définition
La sténose aortique serrée à bas gradient (nommée également à bas débit paradoxal) se définit par une surface valvulaire ≤ 1 cm2 (ou 0,6 cm2/m2)associée à un gradient transvalvulaire paradoxalement bas (gradient moyen < 40 mmHg avec un volume d’éjection systolique indexé < 35 mL/m2) chez un patient ayant une fraction d’éjection du ventricule gauche préservée (FEVG ≥ 50 %) [1]. Cette entité s’observe habituellement chez des femmes âgées et hypertendues ayant une “petite” cavité ventriculaire gauche (VG) et des parois myocardiques hypertrophiées [2]. Les sténoses aortiques à bas gradient dans le contexte d’une dysfonction systolique VG sont abordées dans un autre article de cette revue.
Épidémiologie
Il s’agit d’une entité de description relativement récente. La série canadienne initiale publiée en 2007 rapportait une prévalence d’environ 35 % [3]. Les séries plus récentes rapportent, au sein de populations de patients atteints de sténoses aortiques sévères, une prévalence d’environ 5 % [4, 5]. Ces chiffres sont probablement plus proches de la réalité clinique.
Physiopathologie
La principale explication physiopathologique retenue pour expliquer cette entité est un remodelage VG associant une hypertrophie concentrique et une cavité VG de petit volume relatif. Ce type de remodelage, observé plus particulièrement chez les femmes âgées hypertendues, explique le faible volume d’éjection systolique malgré une fraction d’éjection préservée. En plus des anomalies morphologiques VG, il y a fréquemment des stigmates échographiques de franche dysfonction diastolique [2]. Une fibrose myocardique prononcée a été rapportée chez ces patients [6]. En plus des anomalies du remplissage VG, une altération de la déformation systolique[...]
Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.
Vous êtes abonné(e)
IDENTIFIEZ-VOUS
Pas encore abonné(e)
INSCRIVEZ-VOUS
Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales
S'inscrire