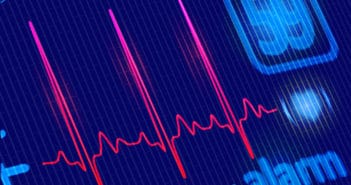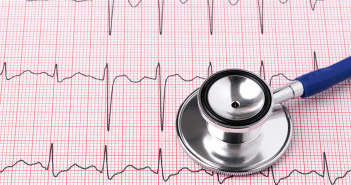Quoi de neuf en hypertension artérielle ?
L’année 2024 a été riche en publications scientifiques dont certaines apportent des informations pouvant avoir un impact sur la pratique quotidienne des cardiologues prenant en charge les patients hypertendus. L’analyse et la synthèse de certaines de ces publications ont été discutées au cours d’entretiens disponibles en podcast sur Spotify sous la rubrique “Les voix de l’hypertension”.
Cet article vous propose la transcription des échanges en Question/Réponses entre “l’hypertensiologue universitaire”, Xavier Girerd et “le cardiologue hospitalier”, Atul Pathak.
La guideline ESC 2024 Hypertension : pourquoi cette recommandation est-elle si différente des précédentes ?