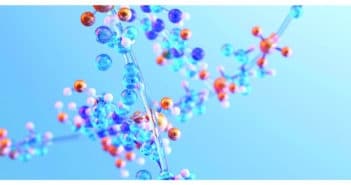
La structure des protéines
Le prix Nobel de chimie 2024 a couronné des découvertes permises par l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) afin de mieux comprendre la structure des protéines.
Ce prix a été décerné conjointement à un Britannique, Demis Hassabis, et un Américain, John M. Jumper, chercheurs de Google DeepMind et à un autre Américain, David Baker, de l’Université de Washington. Ce prix Nobel récompense deux types de travaux complémentaires concernant la structure des protéines, respectivement la prédiction de leurs structures et le dessin de nouvelles protéines. Ainsi, ce prix Nobel consacre un modèle dénommé AlphaFold développé par les chercheurs de GoogleMind, qui est capable de prédire les structures complexes des protéines et David Baker a été couronné, car ces travaux reposant sur l’IA ont permis de concevoir des protéines d’un genre entièrement nouveau.










