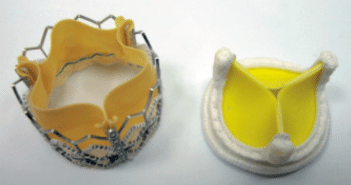Les recommandations anglaises pour la prise en charge de l’HTA : vers un nouveau monde
En 2011, les Britanniques ont émis de nouvelles recommandations pour la prise en charge de l’hypertension artérielle. Celles-ci ont de nombreuses particularités qui les rendent originales et en rupture avec la plupart des recommandations jusqu’ici disponibles.
Ces recommandations anglaises proposent un recours ample et rapide à la MAPA, voire à l’automesure, lorsqu’il existe une suspicion d’HTA afin de la confirmer ou non, et d’adopter une stratégie adaptée au réel statut tensionnel du patient. La classification de l’HTA repose principalement sur la valeur des chiffres tensionnels obtenus le plus souvent en MAPA ou en automesure. Enfin, les recommandations relèguent en troisième intention les diurétiques et en quatrième intention les bêtabloquants.