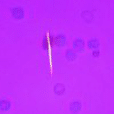Douleur et thérapeutique : quoi de neuf ?
On pourrait interroger l’oracle de Delphes sur le nouveau report du programme d’actions de lutte contre la douleur, qui devrait être présenté d’ici la fin 2013 (Dépêche APM du 12 juillet 2013). Ce programme national devrait prendre la suite du plan douleur 2006-2010 dont le bilan mitigé a été publié en 2011 par le Haut Conseil de la santé publique : “En termes de ressources humaines, les témoignages émanant du terrain font plutôt état de la diminution des postes que de la création d’emplois, ce qui laisse penser (sous réserve d’un bilan réel de l’utilisation des crédits) que cet argent a probablement été utilisé à d’autres fins au sein des établissements de santé”.