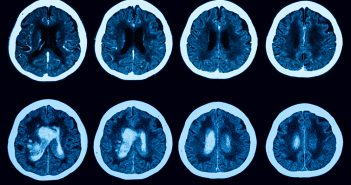Hypertension artérielle et dépression
L’hypertension artérielle (HTA) et la dépression correspondent à deux pathologies extrêmement fréquentes en médecine générale, si ce n’est les deux plus fréquentes et l’HTA est le diagnostic le plus fréquent en médecine cardiovasculaire (CV). Tout praticien, et notamment tout cardiologue, est donc fréquemment confronté à des patients présentant à la fois une HTA et une dépression. Même si ces deux maladies sont clairement indépendantes et font appel à des mécanismes physiopathologiques distincts, certaines études récentes leur trouvent quelques similitudes notamment dans l’inflammation de bas grade et/ou dans l’implication du système rénine-angiotensine-aldostérone. Rappelons également que les médicaments d’une de ces pathologies peuvent théoriquement interagir avec l’autre. C’est le cas pour certains antidépresseurs qui peuvent se compliquer d’HTA mais cela semble, d’après les données récentes de la littérature, être moins fréquent pour les antihypertenseurs et notamment pour les bêtabloquants, longtemps incriminés dans les troubles de l’humeur mais qui paraissent finalement peu impliqués.