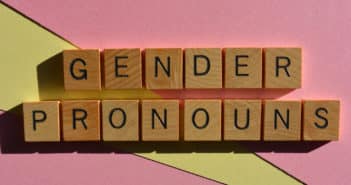Hasard ou pas, à peine écrite, la prédiction terminant le billet paru dans le numéro précédent de Réalités Cardiologiques s’est trouvée réalisée. En effet, les résultats – ou plutôt la méthode – de l’étude STEP, présentés lors des sessions scientifiques de la Société européenne de cardiologie (ESC) en septembre 2021, laissaient envisager qu’il pourrait être possible de traiter l’hypertension artérielle (HTA) sans avoir recours au médecin (fig. 1). Or, à peine cette perspective envisagée, que s’est-il passé, en novembre 2021, lors des sessions scientifiques de l’American Heart Association (AHA) ? Une étude a été présentée, dans laquelle 10 000 patients ont été inclus et qui démontre qu’il est possible de traiter l’hypertension artérielle et l’hypercholestérolémie… sans recours à la présence d’un médecin. Du moins à ce qu’affirment ses auteurs.