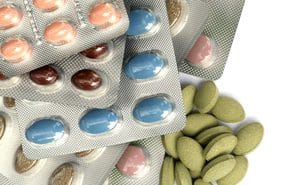Conduite à tenir chez une femme en début de ménopause présentant une ostéopénie
Définition de l’ostéopénie
L’ostéopénie se définit à partir de l’ostéodensitométrie et du T-score que cet examen permet d’établir. Le T-score, exprimé en déviations standard, consiste à comparer la densité minérale osseuse de votre malade à celle d’une jeune femme où la masse osseuse est maximum. Ceci au rachis, au col du fémur et à la hanche totale. On tient compte du site où la densité minérale osseuse (DMO) est la plus basse. La DMO est considérée comme normale lorsque le T-score est supérieur à -1, la malade est ostéopénique lorsque le T-score est compris entre -1 et -2,5 et ostéoporotique lorsque le T-score est inférieur à -2,5 [1].