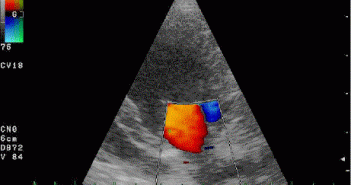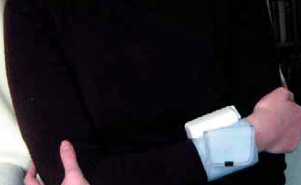
Dossier : Contrôle de l’HTA, Mythes et Réalités
Ce dossier de Réalités Cardiologiques est consacré aux difficultés du contrôle de l’hypertension artérielle. Il sera publié en deux parties : une première dans ce numéro daté de février et la deuxième en mars. En 2000, l’HTA concernait 26,4 % de la population mondiale, soit 972 millions de personnes et près de 8 millions en France. La prévalence est diversement appréciée, entre 15 et 20 %, mais augmente avec l’âge, et 70 % des hypertendus ont plus de 60 ans. Du fait du vieillissement de la population, un nombre croissant d’hypertendus, particulièrement systoliques, est attendu pour les prochaines années, et toutes les études relèvent un contrôle insuffisant des chiffres tensionnels, au seuil de 140/90 mmHg, avec un taux représentatif de 30 à 35 %.