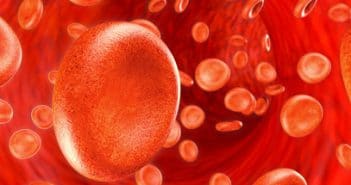Cardiologie interventionnelle : quoi de neuf ?
Rapporter en quelques pages les messages principaux issus de la littérature scientifique publiée au cours d’une année à propos d’un thème aussi évolutif et devenu particulièrement sensible sur le plan médico-économique exige des choix mais aussi des prises de position qui n’engagent que leur auteur.
La parution au cours du congrès de l’ESC des “Recommandations Européennes sur la Revascularisation Myocardique” justifierait à elle seule un commentaire abondant. Résister à ce texte issu d’une autre planète serait à l’évidence à la fois dangereux et vain ! Le commenter est toutefois un exercice passionnant tant il évoque le premier contact avec un instituteur des années 1950 exhibant sa baguette qui allait s’abattre sur nos doigts à la moindre incartade. La vérité, c’était lui. Donc la Vérité, ce sont Eux, les auteurs et pas des moindres ! Aucune issue de secours ! Je serai donc, comme à cette époque reculée de l’école primaire, un élève turbulent, quel qu’en soit le risque !
Je reviendrai à la vraie Science au cours de la seconde partie de l’article en la consacrant à une très bonne nouvelle : la prise en compte et le développement des mesures préventives et thérapeutiques des lésions de reperfusion en phase aiguë d’infarctus myocardique permettant d’espérer franchir une nouvelle étape dans l’amélioration du pronostic de cette maladie. Nous tenterons de combler cet oubli des Recommandations (quelques lignes sur 55 pages) car cette thématique est remplie de promesses. Une véritable bataille est engagée, avec cette fois des chances de succès, contre la mort illégitime des cellules myocardiques par ischémie et reperfusion : éviter, à distance, des fractions d’éjection à 30 % chez des patients traités avant la 2e ou 3e heure.