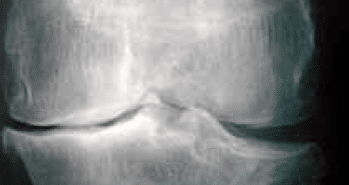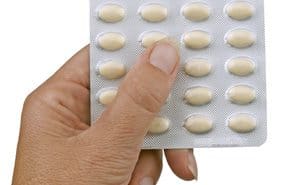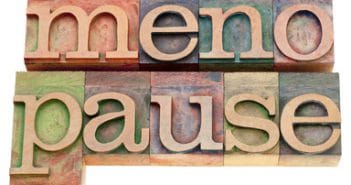
Endocrinopathies de la femme ménopausée
La prévalence de plusieurs pathologies endocriniennes se trouve majorée chez les femmes ménopausées. Il s’agit tout d’abord des affections thyroïdiennes fonctionnelles et/ou dystrophiques avec une augmentation particulièrement nette de l’incidence des hypothyroïdies et des dystrophies nodulaires. L’incidence de l’hyperparathyroïdie primaire est également maximale après la ménopause, et la prise en charge thérapeutique doit tenir compte du risque majoré de perte osseuse. Enfin, les estrogènes exercent de nombreux effets bénéfiques sur le plan métabolique, améliorant la sensibilité à l’insuline et préservant la fonction des cellules du pancréas endocrine. Ainsi, le risque métabolique se majore après la ménopause et les études d’intervention ont clairement montré que l’administration d’un traitement hormonal permet de réduire l’incidence du diabète de type 2.