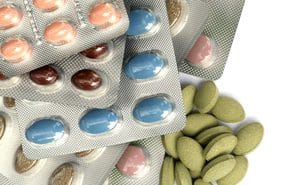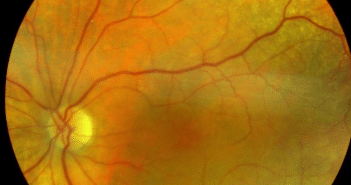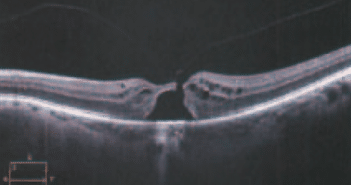Les traitements hypo-uricémiants dans la goutte. Indications et cibles thérapeutiques
La goutte bénéficie, depuis plusieurs années, d’avancées tant sur le plan de la recherche que sur le plan thérapeutique.
Les traitements de fond possibles ont des cibles thérapeutiques variées : inhibition de la synthèse d’acide urique, augmentation de l’excrétion urinaire d’acide urique, conversion de l’acide urique en allantoïne. Ces traitements ont montré leur efficacité, mais présentent aussi des effets indésirables qui nécessitent une surveillance.
La stratégie thérapeutique des patients goutteux reste un challenge pour tout rhumatologue. En effet, les patients ont souvent des comorbidités associées, comme l’insuffisance rénale et les pathologies cardiovasculaires, de même les problèmes d’inobservance sont toujours d’actualité.