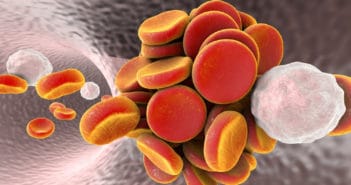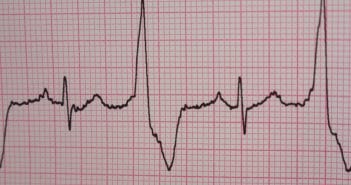Comment contrôler un stimulateur ou un défibrillateur cardiaque en pratique ?
L’intérêt thérapeutique des stimulateurs cardiaques et défibrillateurs cardiaques implantables est aujourd’hui indiscutable. L’implantation de ces dispositifs est l’intervention de rythmologie la plus fréquente. Le suivi après implantation constitue une partie de la prise en charge et conserve une importance majeure.
Compte tenu de la grande diversité des situations cliniques des patients implantés, le rythme du suivi doit être adapté au cas par cas. Les recommandations internationales ont publié un calendrier de suivi minimal comprenant une visite tous les 6 à 12 mois pour les stimulateurs cardiaques et tous les 3 à 6 mois pour les défibrillateurs cardiaques implantables. La réalisation de cette consultation doit inclure l’évaluation clinique du patient, l’analyse de chacun des composants de la prothèse, la bonne adaptation des thérapeutiques aux besoins du patient et la recherche d’événements rythmiques. À la fin de chacune de ces consultations, le praticien peut modifier les paramètres du dispositif, il doit donner un compte rendu au patient que celui-ci conservera au sein de son carnet de porteur de prothèse et le convoquer pour la prochaine visite.