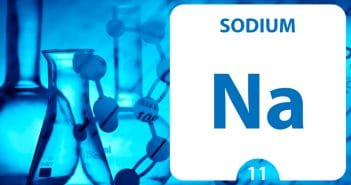Sevrage tabagique : ce qu’il faut savoir de l’entretien motivationnel
L’entretien motivationnel, élaboré dans les années 1980 par William R. Miller et Stephen Rollnick, est une évolution de l’approche humaniste de la relation de soin conçue par Carl Rogers. Il ne s’agit pas d’une technique ni d’une thérapie, mais d’un mode de communication adapté à la relation d’aide. Sa pratique se fonde sur un état d’esprit empathique et collaboratif. L’entretien est centré sur la personne et met en œuvre des outils de communication adaptés.