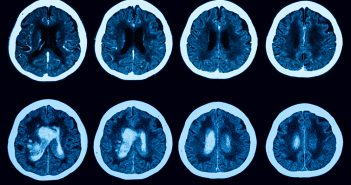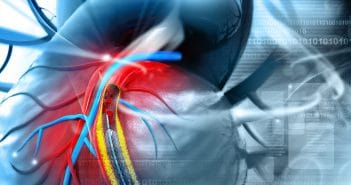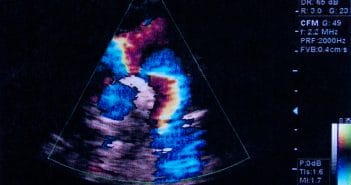Quelle place pour l’ivabradine et la digoxine dans le traitement de l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection réduite ?
Dans l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection réduite, un des facteurs pronostiques importants à prendre en compte est la fréquence cardiaque. Pour la contrôler, le traitement recommandé de base est représenté par les bêtabloquants. Mais si elle persiste au-delà de 70 battements par minute, l’ivabradine a démontré un effet favorable sur la morbi-mortalité qui s’ajoute à celui des bêtabloquants, sans compter son intérêt dans l’étiologie ischémique.
La digoxine peut être envisagée en cas de fibrillation atriale mais aussi en rythme sinusal, même si les recommandations européennes la considèrent comme une thérapie de dernier recours. Il conviendra seulement de maintenir la digoxinémie ≤ 0,9 ng/mL.