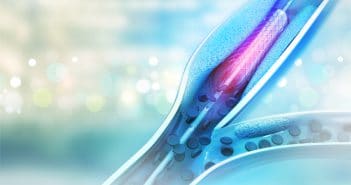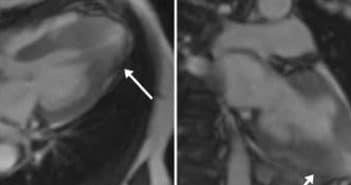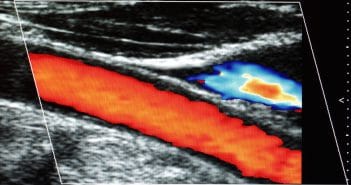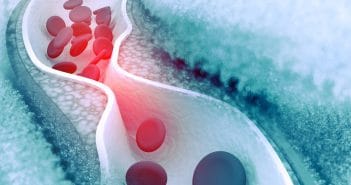De la fibrillation atriale paroxystique à la fibrillation atriale persistante : incidence, facteurs prédictifs et impact clinique de la progression de l’arythmie
La fibrillation atriale (FA) est une pathologie évolutive, progressant souvent de sa forme paroxystique à persistante, puis permanente.
Sur le plan physiopathologique, la transition de l’arythmie s’explique par le passage d’une maladie dépendante des “gâchettes”, représentées le plus souvent par des extrasystoles veineuses pulmonaires, à une maladie dépendante du substrat atrial, par le biais d’un remodelage électrophysiologique et structurel des oreillettes qui se met progressivement en place. Le risque de transition est estimé entre 10 et 20 % à 1 an, et à 30 % à 5 ans, risque plus faible chez les patients ayant bénéficié d’une ablation de l’arythmie.
Identifier les patients à risque d’évolution rapide permettrait de les prendre en charge de façon plus rapide et d’obtenir ainsi un meilleur maintien du rythme sinusal à long terme.