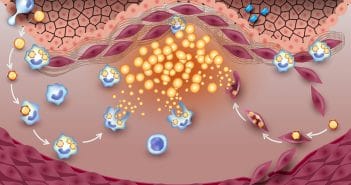
Consensus français sur la stratégie de baisse du LDL-c en post-syndrome coronaire aigu
La justification scientifique de la prescription des statines à la phase aiguë d’un syndrome coronarien aigu a fait l’objet de discussions de consensus aboutissant à la publication de deux algorithmes. Ces algorithmes sont décrits et expliqués dans cet article.
Parmi les différents points abordés, on trouve l’utilisation de statines dès l’admission et à forte intensité, l’utilité de doser le LDL-c, la justification d’une cible de LDL-c, l’estimation du LDL-c sous traitement et l’optimisation du traitement avant la sortie.
Au cours du suivi, l’adaptation thérapeutique est également discutée en fonction du traitement suivi et de la valeur du LDL-c.










