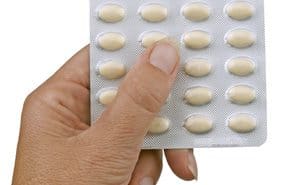
Quel intérêt du dosage pour la pratique des biomédicaments et des anticorps induits ?
Le suivi thérapeutique pharmacologique (STP) et immunologique des biomédicaments est très séduisant car il pourrait permettre d’expliquer, au moins en partie, la réponse variable des patients et de mieux comprendre certaines situations cliniques observées en pratique quotidienne (échec primaire, échappement, réaction allergique).
L’immunogénicité (développement d’anticorps anti-biomédicament) semble surtout concerner les anticorps monoclonaux. Des travaux de plus en plus nombreux plaident en faveur de ce concept, mais il reste encore à démontrer clairement sa supériorité comparativement à un suivi clinique classique en pratique quotidienne.










