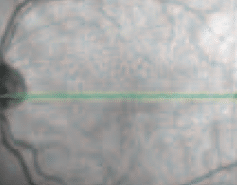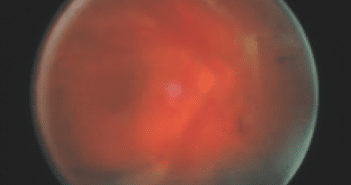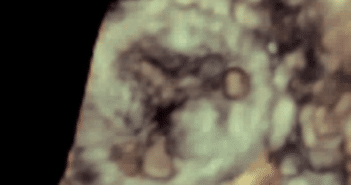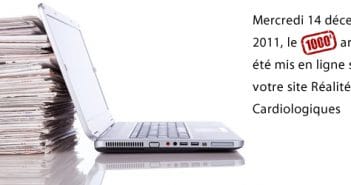Place des analogues du GLP‑1 dans le traitement du diabète de type 2
Le développement des analogues de GLP‑1 répond à une attente des diabétologues et de leurs patients car la manipulation du système incrétine est potentiellement une cible thérapeutique importante. Les résultats des essais cliniques sont contrastés (amélioration du service médical rendu mineur). Les deux analogues actuellement commercialisés sous forme injectable (exénatide et liraglutide) ont en monothérapie un effet hypoglycémiant similaire à celui des sulfamides. De ce fait, l’indication des analogues de GLP‑1 est typique du patient diabétique de type 2 en échec de traitement oral, l’analogue étant prescrit en association avec un ou deux antidiabétiques oraux. La baisse de poids possible est généralement transitoire et la restauration d’une insulinosécrétion défaillante est variable avec néanmoins peu de risques de survenue d’une hypoglycémie.