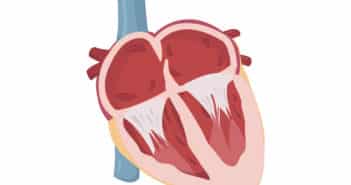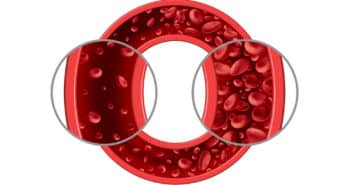
Comment en pratique prendre en charge un insuffisant cardiaque en carence martiale ?
La prise en charge de la carence martiale doit s’inscrire dans le parcours de soins de tout insuffisant cardiaque. C’est en effet la comorbidité la plus fréquente au cours de l’insuffisance cardiaque (IC), qu’elle soit aiguë ou chronique, à fraction d’éjection réduite ou préservée.
Ses conséquences sont sévères, participant à l’altération des capacités à l’exercice, le fer étant un oligoélément indispensable au fonctionnement des cellules à haute demande énergétique, comme les cardiomyocytes et les myocytes squelettiques, majorée en cas d’anémie, et grevant le pronostic.
Son diagnostic, par le dosage de la ferritinémie et du coefficient de saturation de la transferrine (CST), doit être systématique, avec un bilan biologique au moins annuel. Son traitement est aisé, efficace et bien toléré à condition de recourir à la voie intraveineuse et au fer carboxymaltose compte tenu du peu d’efficacité de la voie orale.
Quatre essais contrôlés, un dans l’IC aiguë et trois dans l’IC chronique à fraction d’éjection réduite, ont démontré son efficacité pour améliorer les symptômes, les capacités d’effort et diminuer le risque d’hospitalisation.