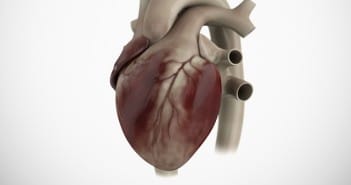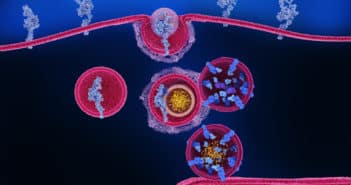Dans le cadre d’une étude pronostique, l’objectif est en général d’évaluer l’association statistique existant entre la mesure d’une variable d’intérêt (biomarqueur, facteur d’exposition…) et la survenue d’un événement clinique. Comme nous l’avons déjà abordé au sein de cette rubrique, afin de s’amender du risque de facteur de confusion potentiel lors de la mesure de cette association, réaliser une analyse multivariée permettant un ajustement sur ces facteurs de confusion est devenu la règle. Cela permet d’évaluer s’il existe bien une association “indépendante” entre la variable d’intérêt mesurée et la survenue de l’événement étudié. Dans ce sens, le modèle statistique le plus couramment utilisé pour ce type d’analyse est le modèle de Cox. Cependant, depuis déjà plusieurs années, la quasi-totalité des grands journaux de cardiologie exige systématiquement l’utilisation de modèles statistiques plus complexes, tenant compte de ce qu’on appelle le “risque compétitif entre les événements”. Ce type de modèle, bien plus exigeant et spécifique dans son analyse que le traditionnel modèle de Cox, est de plus en plus souvent utilisé dans les grands essais cliniques. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi dans cet article d’expliquer simplement le principe du risque compétitif et de développer les points clés permettant de comprendre le résultat d’un modèle utilisant une analyse en risque compétitif.